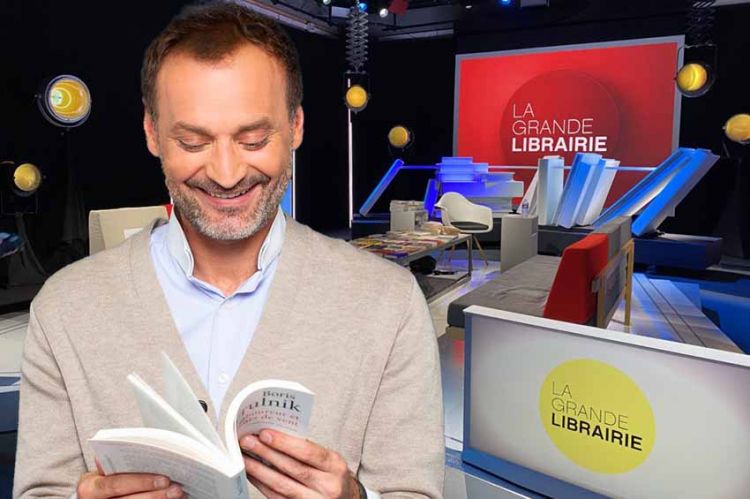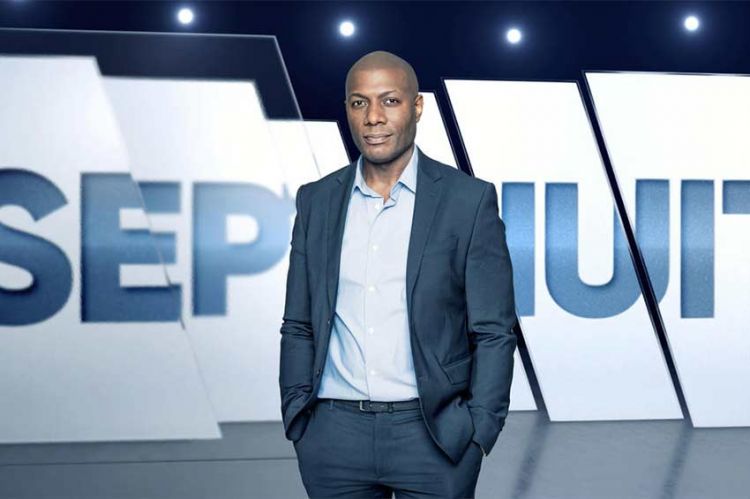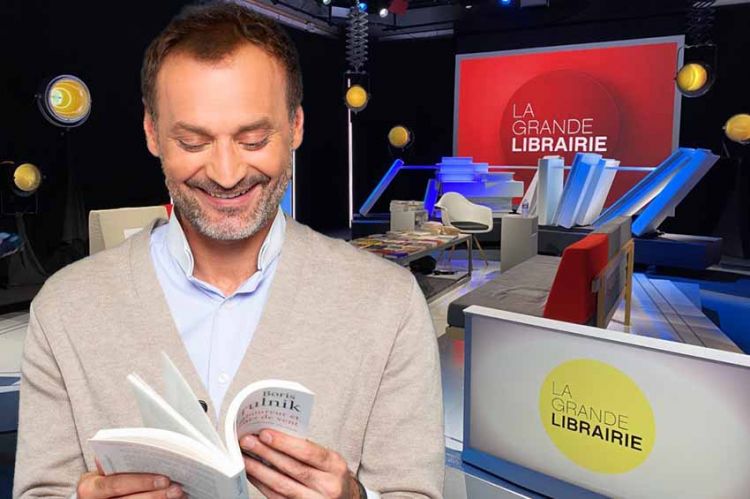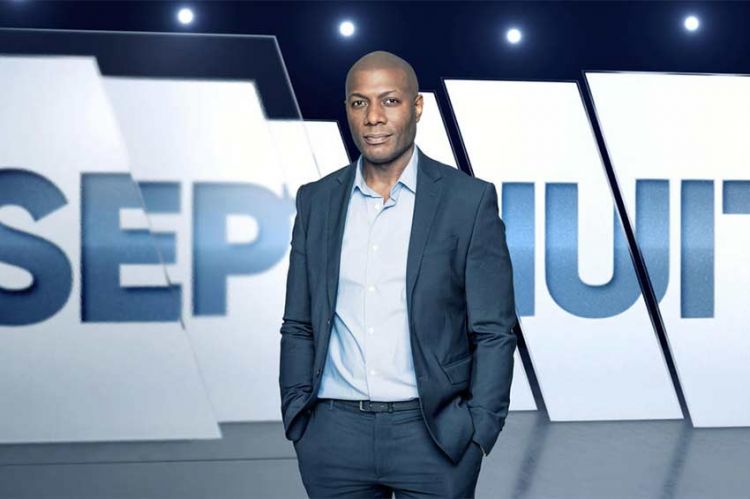Roubaix : la ville aux milles cheminées d’usine. La deuxième Manchester. L’une des villes les plus pauvres de France, qui n’en finit plus de constater la chute de son activité textile, ses boulots et ses outils partis à l’étranger, ses savoirs faire quasi-disparus, et son peuple d’ouvrières et d’ouvriers déshonoré·e·s.
Quand éclate l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, les Français réalisent l’étendue de la désindustrialisation et ses conséquences: nous ne fabriquons pas de masques pour nous protéger. Une poignée d’hommes et de femmes vont alors tenter d’inverser la courbe du destin, de relocaliser, de rebâtir une filière textile, de refaire.
Dans l’urgence, et l’énergie de l’espoir, cette aventure extra-ordinaire réunit un industriel qui, délocalisations après délocalisations, n’a pourtant jamais cessé de croire en une production textile française.
Un Haut-commissaire à l’inclusion, nommé par le gouvernement au lendemain de l’annonce du confinement, qui compte bien limiter les dégâts de la crise pour les plus fragiles et réussir une entrée fracassante en politique.
Une jeune couturière passionnée de mode, issue d’une famille modeste et nombreuse, pour qui faire des masques est la première étape d’une trajectoire de créatrice.
Une Marseillaise venue s’installer à Roubaix pour aider les décrocheurs scolaires et tous ces gens qu’on qualifie « d’inemployables ».
Et enfin, l’héritier d’un savoir-faire textile, celui d’une famille thaïlandaise qui a toujours été forcée de flirter avec l’illégalité pour avoir du travail.
Note d'intention des réalisateurs
L’épidémie de covid, notre incapacité à fabriquer des biens aussi basiques qu’un masque en tissu, et notre dépendance aux fournisseurs asiatiques ont révélé de façon saillante notre vulnérabilité sanitaire et notre faiblesse industrielle. Et depuis, la nécessité de relocaliser, de réindustrialiser, pour des questions de souveraineté stratégique ou pour l’emploi est sur toutes les lèvres.
Cela faisait longtemps que nous cherchions à raconter la désindustrialisation française, et à savoir s’il était possible d’inverser le mouvement, et de rebâtir une industrie, ou s’il s’agissait juste d’une chimère de plus des gouvernements successifs.
Alors quand Christophe Lepine, chantre du Made in France, que Benjamin Carle avait déjà croisé dans un précédent documentaire, nous a parlé de tissus, de masques, de machines à coudre qu’il fallait faire venir des balkans, de l’urgence aussi, nous sommes partis avec lui dans sa camionnette. Jusqu’à Roubaix. En plein confinement, nous l’avons suivi comme on va voir une expérience en laboratoire. Et puis nous avons été touchés, littéralement happés, par Olympe, Mohammed, Stéphanie, Thibaut, Tony, et bien d’autres, des magrébo-ch’ti, des gars du Nord, des filles du Sud, des laotiens, des thaïlandais, tous décidés à se battre pour sortir de leur mouise, et à se battre pour les autres pour dépasser la crise. Ils sont devenus nos personnages. Et nous avons pris le pari un peu fou de documenter cette aventure, à bord de camionnettes bruyantes, dans une ancienne usine de chaussettes, sur des aires d’autoroutes désertes, dans l’une des dernières fabriques de caoutchouc du pays, à l’intérieur d’une courée de Roubaix, d’une cité HLM de Villeneuve d’Ascq, à Bercy, au dernier étage du Ministère de l’Economie; en français, en arabe, en laotien, en thaïlandais, dans une France confinée, puis déconfinée, mais toujours industriellement déconfite.
Suivre les personnages de RE|FAIRE est une formidable opportunité de découvrir concrètement la difficulté d’un tel projet de réindustrialisation. Car les obstacles sont nombreux. Il y a le travail d’évangélisation pour recréer une filière française tombée de haut à la fin du XXème siècle et qui ne réussit pas à retrouver les pièces de son puzzle; la formation de jeunes apprenti·e·s, mécanicien·ne·s, modélistes ; la question du prix - primordiale ; celle de la taille critique ; celle des avantages comparatifs dans un marché qui reste(ra) mondialisé ; celle des donneurs d’ordres ; et du besoin de financement.
Ce film est aussi excitant que âpre et l’histoire que nous avons suivie aussi enthousiasmante qu’incertaine, car ni les protagonistes de cette aventure ni nous, n’en connaissons l’épilogue. Vont-ils collectivement réussir à profiter de cette crise pour relancer l’industrie textile? Vont ils individuellement parvenir à améliorer leur situation? Notre objectif a été de raconter les étapes de cette aventure économique et sociale, qu’elle soit couronnée de succès ou vécue comme un échec.
Refaire est toujours compliqué. Parce que le monde a changé, parce qu’on a oublié comment on avait fait la première fois et aussi parce que refaire les mêmes choses comporte des risques, notamment celui de réveiller les fantômes du passé.
C’est encore plus vrai dans le textile. C’est encore plus vrai à Roubaix.